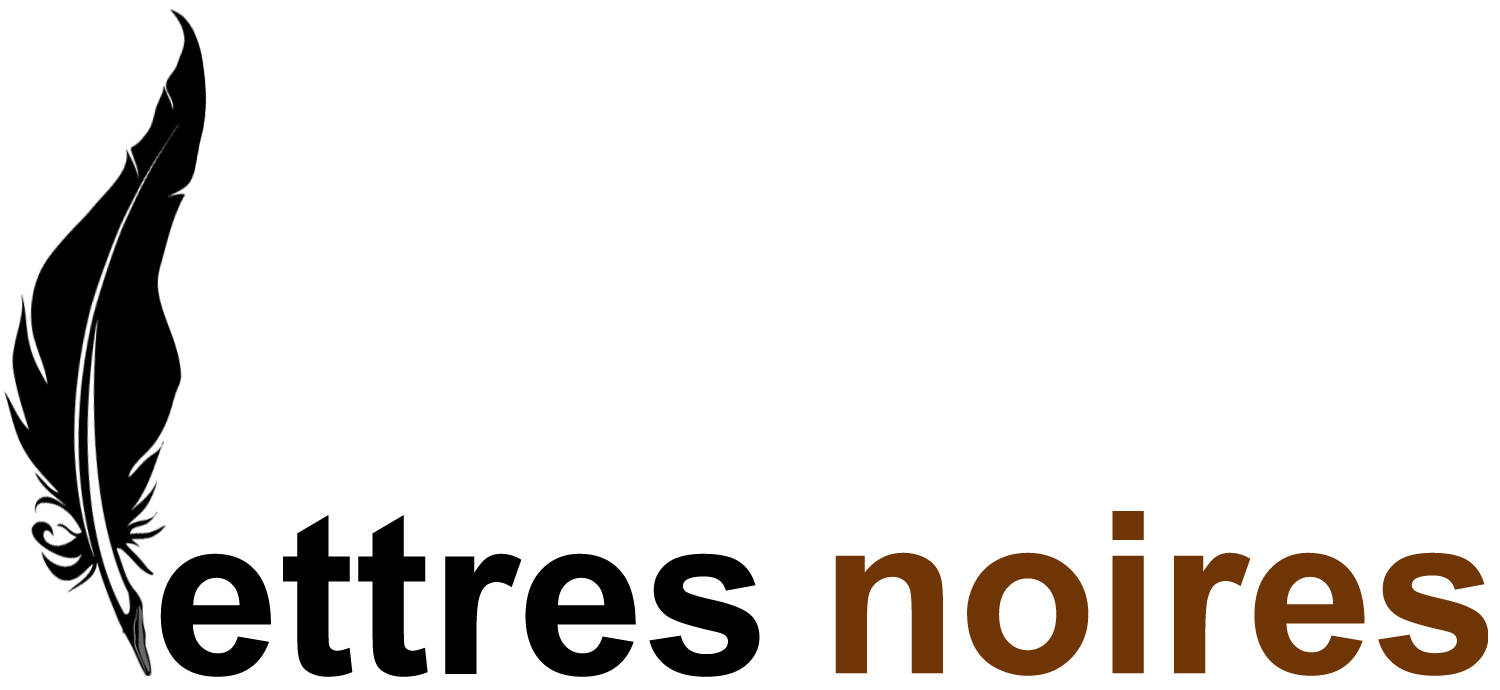Thomas Sankara disait qu’«une bibliothèque, c’est dangereux. Ça trahit. D’ailleurs, je n’aime pas dire ce que je lis. Jamais je n’annote un livre ou je ne souligne des passages. Car c’est là que l’on se révèle le plus. Cela peut être un vrai carnet intime.»
Lettres Noires, c’est parler de livres, c’est partager ce que je lis, mais c’est aussi accepter de me livrer moi-même par petits bouts. Au fil des mois, au fil des publications, je mets ma pudeur de côté. A chaque livre présenté, chaque avis donné, je dévoile une facette de moi, de mon univers. Et là, vous devez vous demander « Mais où veut-elle en venir ? » Eh bien cet article, je l’ai écrit pour partager avec vous les origines de ma passion pour la lecture, et pourquoi ce que je lis est toujours souvent orienté vers l’Afrique, et son héritage à travers le monde.
(Ou pour faire simple, je vais raconter un peu ma vie, parce que je m’ennuie et que je vous aime bien beaucoup !)
Pour la petite histoire, j’ai toujours aimé lire tout ce qui me passait sous la main. Des magazines « Femme actuelle » de ma mère, aux livres/essais/journaux sociologiques et politiques de mon père, en passant par les Harlequin que ma grande sœur cachait sous son lit :), rien ne m’échappait. Comme une boulimique, je ne me rassasiais de rien, et avais faim de tout. Au primaire, début collège, mon palais livresque n’était pas encore aussi défini qu’aujourd’hui, mais j’avais déjà un goût certain pour un type de lectures : celles pour lesquelles j’en redemande, celles qui me surprennent et surtout, celles qui me font découvrir le monde depuis ma chambre. Alors très tôt, je me suis tournée vers Dan Brown, Jean-Christophe Ruffin, J.K. Rowling, Harlan Coben, Nora Roberts, et plein d’autres auteurs… occidentaux. Je les lisais, et relisais (il y en a que j’ai lu 5,6 fois, voire plus), sans jamais en avoir assez.
A quel moment ai-je donc été réellement attirée par les Lettres Noires?
Ma première « confrontation » avec un roman africain a été à 11 ans, avec Pain Sucré de Mary Lee Martin Koné. Il raconte l’histoire de la petite Amoin, qui ne rêvait que de la ville, qui rêvait trop grand pour elle, et qui a appris à ses dépens que ce que l’on désire n’est pas forcément ce qu’il nous faut. Je ne savais pas vraiment si je lisais ce livre par plaisir, ou si je le faisais mécaniquement, comme un automate, parce que c’était une lecture obligatoire du programme scolaire de français. Cette même année, j’ai lu Maïmouna d’Abdoulaye Sadji… Maïmouna, ou l’Etoile de Dakar comme surnommée dans l’oeuvre. Une petite fille, à peine faite femme par Dame Nature, qui brilla par sa beauté dans un monde de grands, et surtout, dans un monde d’hommes. Un monde pas encore fait pour elle, et qui a fini, comme Amoin, par l’éteindre. Au final, Maïmouna n’était pas une étoile destinée à scintiller longtemps dans le ciel. Elle était de ces étoiles qui suscitent un plaisir fugace, ces étoiles qui passent trop vite dans la Vie, et qui fatalement, disparaissent. La petite fille que j’étais moi aussi à l’époque était outrée par cette Afrique décrite par deux fois déjà, à travers des personnages qui auraient pu être MOI. Au collège, je n’ai pas aimé ces deux livres, je vous le dis tout de suite. Ils me semblaient trop proches l’un de l’autre, et trop loin de ce que je cherchais dans un roman.
D’ailleurs, ai-je seulement apprécié les autres œuvres africaines qui m’ont été imposé tout au long de mon parcours scolaire? L’enfant noir (Camara Laye), Les bouts de bois de Dieu (Sembène Ousmane), Les soleils des Indépendances (Amadou Kourouma)… ? Avec du recul, je dois avouer que je les lisais, certes, mais sans grand intérêt. J’avais juste hâte de passer mon contrôle de français, et ensuite me replonger dans les lectures de MON choix qui étaient (à mes yeux de jeune lectrice) beaucoup plus intéressantes, enrichissantes, originales, drôles… et des adjectifs dans le genre, j’en ai plein d’autres encore à donner 🙂
Il n’y avait pas un véritable rejet de la littérature africaine de ma part, mais une certaine incompréhension et lassitude. Les sujets et enjeux étaient toujours les mêmes : conflits générationnels, la tradition face aux dérives de la modernité, la colonisation, les indépendances… Nos professeurs de français nous en faisaient manger à toutes les sauces possibles, au point de rendre ces lectures indigestes. Inconsciemment, je les ai placés dans le rang des lectures-corvées, et je continuais à dévorer, dans le secret de ma chambre, Harry Potter, Le parfum d’Adam, Anges & Démons, etc.
Ce n’est qu’en classe de 1ère, en lisant Le cercle des tropiques d’Alioum Fantouré – qui lui n’était pas au programme – (vous pouvez lire ma revue sur ce roman ici), que j’ai eu LA révélation. Ce n’est pas la littérature africaine qui est ennuyeuse et redondante, mais les œuvres choisies au programme ne correspondaient tout simplement pas à mes attentes! Ou peut-être que mon esprit anti-conformiste et, disons-le, rebelle indépendant, développé très jeune, m’empêchait d’apprécier un livre imposé par l’école. Bref. En prenant encore plus de recul (la remise en question, c’est important les amis), je dois aussi avouer que je n’avais pas, par le passé, la maturité nécessaire pour apprécier certains livres à leur juste valeur.
Le Cercle des tropiques m’a rappelé en bien des points mon pays le Gabon, les pays qui nous sont frontaliers, et bien d’autres encore. Ce livre m’a fait comprendre que si la majorité des romans africains que j’avais lus jusqu’alors me semblaient répétitifs, et ne pas se défaire du spectre de la colonisation, c’est bien parce qu’il s’agit de NOS réalités. Et nos réalités, elles n’ont (malheureusement) pas changées depuis les 60 dernières années. Les défis d’hier, restent ceux d’aujourd’hui, auxquels on a rajouté plusieurs autres problématiques (l’environnement, la condition de la femme, l’immigration…). En gros, nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge, et les auteurs, pour la plupart, se font les griots intemporels de notre société. Ce n’est que lorsque j’ai compris le rôle primordial de la littérature dans notre société et la compréhension que nous pouvons avoir de celle-ci, que je me suis réconciliée avec les Lettres Noires. Ou devrais-je dire, que j’ai appris à les aimer. Je les ai re-découvertes et affectionnées au-delà de ce que j’aurais pu imaginer.
Mon horizon s’est également élargi : j’ai découvert les livres d’épouvante, les bandes dessinées, les romances, à l’Africaine ! Une multitude de trésors, peu explorés et assez méconnus jusqu’à présent étaient désormais à ma portée. Neuf ans après ce tournant décisif, je ne lis pratiquement plus que des auteurs africains et afro-descendants.
Ces livres sont les magnifiques témoignages des générations qui nous ont précédés et le legs des auteurs d’aujourd’hui aux générations futures. Ces livres me font voyager à travers les époques, les continents, les cultures, et me font même voyager à travers mon propre pays, le Gabon, que je crois souvent bien connaître, mais Honorine Ngou, Okoumba-Nkoghe, Justine Mintsa, me prouvent toujours que je n’en saurai jamais assez.
En lisant un livre africain ou afro-descendant, je ne crains plus de retrouver les « mêmes » problématiques. Je ne crains plus de voir des personnages sous le joug d’un mari, d’une marâtre, d’un colon, d’un père, d’un charlatan etc… Parce que ces scénarii-là sont toujours d’actualité, et sont partout autour de nous. Ces romans que je trouvais avant redondants, peu flatteurs, peu originaux, je les vois aujourd’hui tels qu’ils sont VRAIMENT.
Pour le plaisir, et pour finir, je vous laisse ci-dessous les 3 livres qui m’ont réconciliée avec les Lettres Noires. Ceux qui m’ont fait succomber. Qui sait, peut-être vous inspireront-ils, à votre tour ?
1 – Le cercle des Tropiques – Alioum Fantouré (Guinée)

Vous retrouverez mon avis sur ce livre ici
2 – Gouverneurs de la rosée – Jacques Roumain (Haïti)
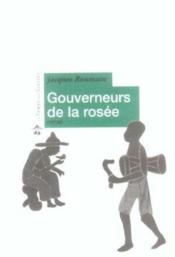 Ce qui m’a plu dans ce livre ? L’auteur qui raconte la misère à Ayiti, petite Ayiti, sur un fond de romance, et avec une bonne dose de créole, et d’expressions atypiques. Je n’en dis pas plus parce qu’un article dédié à ce grand classique arrivera (très) bientôt.
Ce qui m’a plu dans ce livre ? L’auteur qui raconte la misère à Ayiti, petite Ayiti, sur un fond de romance, et avec une bonne dose de créole, et d’expressions atypiques. Je n’en dis pas plus parce qu’un article dédié à ce grand classique arrivera (très) bientôt.
3 – Allah n’est pas obligé – Amadou Kourouma (Côte d’Ivoire)
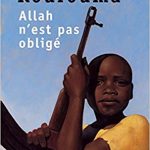 « Allah n’est pas obligé d’être juste dans toutes ses choses ici-bas ». Ce n’est pas moi qui le dis, c’est un adage qui a valu ce titre au roman. Et parce qu’Allah n’est pas obligé d’être juste… eh bien le trop jeune Birahima ne voit pas de mal, au final, à être enrôlé comme enfant-soldat dans la guerre du Libéria. Mais chuuut. Un article sera bientôt sur le blog.
« Allah n’est pas obligé d’être juste dans toutes ses choses ici-bas ». Ce n’est pas moi qui le dis, c’est un adage qui a valu ce titre au roman. Et parce qu’Allah n’est pas obligé d’être juste… eh bien le trop jeune Birahima ne voit pas de mal, au final, à être enrôlé comme enfant-soldat dans la guerre du Libéria. Mais chuuut. Un article sera bientôt sur le blog.
Et vous les amis, avez-vous toujours lu des auteurs afro ? Si oui, quelles œuvres préférez-vous ?
Merci d’être là, de me suivre, de me lire. One love!