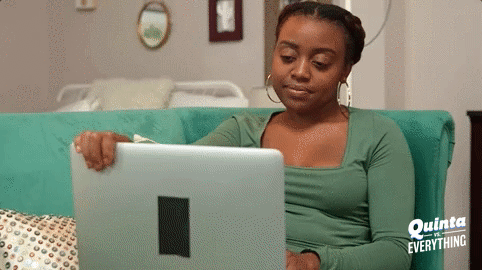« Echapper à l’Occident suppose d’apprécier exactement ce qu’il en coûte de se détacher de lui ; cela suppose de savoir jusqu’où l’Occident, insidieusement peut-être, s’est approché de nous ; cela suppose de savoir, dans ce qui nous permet de penser contre l’Occident, ce qui est encore occidental et de mesurer en quoi notre recours contre lui est encore peut-être une ruse qu’il nous oppose et au terme de laquelle il nous attend, immobile et ailleurs. » Valentin Yves Mudimbé.
On me demande souvent comment s’est passé mon retour au Gabon. Ma « réadaptation ». Comment je vis les travers de mon pays, ses manquements, ses limites. Comment je supporte ses politiciens véreux et ses journaleux. Sourire. Ces questions me font sourire. Elles ne sont pas pour moi. Je ne les comprends pas. Peut-on seulement se réadapter à un pays dont nous ne parvenons pas à nous défaire, même lorsque tout de lui nous abhorre? Peut-on seulement se réadapter à un pays que l’on n’a jamais quitté ? Il m’est impossible de parler de retour. Alors je vous parlerai d’attachement, et parfois de désamour. Je vous parlerai de tous ces petits « rien », qui font que le Gabon, je ne l’ai jamais vraiment quitté.
Étudiante. Immigrée ? Excisée ?
Je suis arrivée en France en septembre 2012 avec mon baccalauréat B (ES) en poche et ma 18ème bougie fraîchement soufflée, excitée comme une puce de pouvoir ENFIN voler de mes propres ailes, loin de toute autorité parentale. Poursuivre mes études à l’Université Omar Bongo de Libreville ne m’a jamais effleuré l’esprit. J’ai beau profondément tenir à mon pays, j’ai une conscience aiguë des carences qui sont les siennes. Partir après le baccalauréat est une des meilleures voies pour tout boursier ou bachelier soutenu par sa famille. J’ai grandi au rythme des faits divers et légendes urbaines autour de cette université Omar Bongo. Grèves interminables, retard du versement des bourses, insalubrité du campus, bizutage, taux de redoublement élevé, intimidation du corps professoral et des étudiants dits « caciques ». J’ai donc grandi (à tort ?) avec la certitude que si je souhaitais m’épanouir durant mes années étudiantes, je devais accepter l’idée de vivre ailleurs, pendant au moins cinq années. Et cet ailleurs, j’y suis allée, avec l’intime conviction que j’y étais à durée déterminée. Pas question pour moi de m’éterniser. « Cinq ans, pas plus » disais-je alors. Au final j’en ai fait six.
Par quoi ne suis-je passée durant ces six années ? Comme la majorité des étudiants étrangers, je pourrai écrire un petit recueil de perles racistes que j’ai entendues, entre la Loire Atlantique (Saint-Nazaire) et la Picardie (Saint-Quentin) où j’ai vécu. Je peux vous assurer que sur ma nationalité, mon teint, ma façon de parler… j’ai entendu de tout. La question la plus marquante étant, quelques semaines après mon arrivée, un promotionnaire (non, je ne dirai pas camarade de promotion !) qui, se croyant un peu trop en confiance, m’a demandée si j’étais excisée. Je suis gabonaise, je porte un prénom chrétien, et Sébastien me demande si je suis ex-ci-sée ?

Même si je m’appelais Fatoumata et que je venais du fin fond du Foutah Toro (excusez le cliché grotesque), cette question ne serait toujours pas acceptable ! A partir de quel moment ose-t-on questionner ainsi une personne que l’on “connaît” depuis deux semaines ? Et encore, je vais vous dispenser d’un inventaire des autres réflexions déplacées et insultantes auxquelles j’ai eu droit. Je pense que Rokhaya Diallo sait mieux que moi parler des expériences du racisme. Je ne souhaite pas m’appesantir sur les rencontres négatives et racistes que j’ai eues en France. Des milliers d’afropéens s’en plaignent déjà au quotidien. Je n’ai jamais souhaité « m’afro-péaniser » ni même m’intégrer. Toute mon expérience du racisme en France durant mes années étudiantes sont davantage anecdotiques que douloureuses. Je ne me suis jamais sentie rejetée, exclue ou invisibilisée, dans la mesure où ce n’était pas la société dans laquelle je souhaitais m’établir. Je me suis donc toujours considérée comme de passage, immigrée temporaire, bien qu’ayant développé une affection particulière pour Paris 😊.
Oui, mon discours peut sembler catégorique, mais ce n’est pas parce que je ne me voyais pas vivre en France, que j’oublie tout ce que j’ai aimé de ce pays. Je dois à la France deux amies qui me sont chères, qui se reconnaîtront certainement dans cet article (Miss Straub and Miss Djibouti). Aussi, c’est le pays qui m’a permis d’obtenir ma première expérience professionnelle (en alternance). J’y ai des souvenirs immuables et je voudrais certainement y retourner dans les années à venir. La France multiculturelle, la France des Lumières, des salles de théâtres combles, de la bonne gastronomie, des expositions originales, des musées des Arts et Civilisations, des festivals d’été… Cette France-là, croyez-moi, je l’ai aimée. Je chéris chacun des moments passés, surtout maintenant que je suis de retour dans mon petit pays qui manque cruellement d’activités culturelles. Toutefois, je n’ai jamais perçu la France comme une terre d’accueil. Je n’en cherchais pas une. Je n’en voulais pas une. La France n’était pas un accomplissement, un cocon ni même une terre où me poser. La France a été un moyen. Moyen d’étudier à petit prix, d’avoir d’autres opportunités, découvrir, comprendre, et partir. Pendant 6 années, je me suis sentie en mission. Avoir un diplôme, un minimum d’expérience, travailler deux fois plus, épargner deux fois plus… M’amuser! Ne jamais cesser d’expérimenter, tout en n’oubliant pas mon objectif premier, la finalité de ce cheminement : rentrer.
Vivre en France, sous le prisme de ma pensée afrocentrique, m’a aidée à ne pas perdre de vue mon but et à ne pas me compromettre au nom d’un confort de vie superficiel. Vivre sous le prisme afrocentrique m’a aidée à ne pas me perdre.
Histoire d’un non-retour
Six années passent bien plus vite qu’on le pense. Ou du moins, que je le pensais. Ce temps qui me semblait interminable s’est mis à courir de façon diabolique en 2018. En un clin d’œil, l’espace de quelques mois, j’étais étudiante, alternante chez un équipementier automobile, jeune diplômée, puis, bien sûr, chômeuse !! Cette année-là, j’ai participé au forum AfricTalent à Paris, j’ai passé 20h/semaines sur LinkedIn, et j’ai multiplié les demandes d’emploi auprès des rares entreprises africaines qui ont un espace en ligne de recrutement. Un mois avant mon retour, je n’avais reçu que 2 réponses (négatives) sur plus de 70 demandes d’emploi envoyées. Mon moral était au plus bas. Malgré tout, j’ai confirmé mon vol retour. J’avais l’intime conviction que la recherche d’emploi se ferait mieux sur place. Aujourd’hui j’ai compris que chez nous, les entreprises ont beau avoir des portails de recrutement en ligne, pour contacter leurs services ressources humaines, rien ne vaut le bon vieux “dossier papier”. Régression, me direz-vous. Moi je répondrai : BIENVENUE SOUS LES TROPIQUES !

Je suis rentrée en octobre 2018. Rien n’avait changé. Les mêmes nids-de-poule cratères sur le réseau routier, le même système bancaire archaïque, les mêmes coupures d’électricité, le même réseau de télécommunication hors de prix. Rien n’avait changé. Bien triste constat, pour un pays d’1,5 million d’habitants dont la manne pétrolière et minière aurait dû suffire à mettre à l’abris tout citoyen.
Etait-ce suffisant pour me décourager ? Not at aaaaall, guys !!

Je suis arrivée prête à tout niquer déchirer ! Je me suis inscrite à l’Office Nationale de l’Emploi (O.N.E.) et… PAUSE !
Laissez-moi vous parler un peu plus de cet organisme du Ministère Gabonais du Travail. L’une des rares organisations étatiques de mon pays qui FONCTIONNE comme il se doit, mérite que je passe plus de 2 secondes sur son cas 😊.
L’O.N.E. a été pour moi un passage obligé, car nulle demande d’emploi ne s’envoie au Gabon sans posséder un identifiant O.N.E. et sans que celui-ci ne soit mentionné sur le CV du demandeur. Dans le cadre de mon inscription à l’O.N.E., j’ai eu affaire à une réceptionniste agréable (en fonction du jour, je dois l’avouer ahah), qui m’a donné tous les renseignements et documents nécessaires à mon dossier dès le premier jour. Un exploit !
Quelques jours après cette inscription, j’ai obtenu un rendez-vous avec un conseiller O.N.E. au cours duquel nous avons discuté de mon (jeune) parcours, de mon projet professionnel et des secteurs d’activité qui m’intéressaient. Pour être honnête, je me suis demandée à quel moment le Gabon était arrivé à proposer un tel service aux demandeurs d’emploi ?! Mon conseiller O.N.E. était plus ou moins professionnel, à l’écoute et bon formateur. En prime, tout demandeur d’emploi au Gabon via l’O.N.E. bénéficie d’une formation de deux jours sur les techniques de recherche d’emploi. Je me suis donc bien vite retrouvée en atelier avec des jeunes et moins jeunes, des cadres et non-cadres, des mécaniciens, serveuses, ingénieurs, comptables et soudeurs. Nous, des personnes aux trajectoires tellement différentes, étions réunies afin de mettre à l’épreuve nos CV et lettres de motivation. Toujours en atelier, nous faisions également des simulations d’entretiens d’embauche, sous forme de jeux de rôles. J’ai trouvé en l’O.N.E. tout ce que j’attendais d’une agence nationale au service des gabonais.
Néanmoins, ne vous y trompez pas. Mon ton enjoué, que vous pourrez même trouver candide, vient du fait que j’écrive ce billet 1 an et 6 mois plus tard. Le temps rend tout souvenir meilleur. Il confond les émotions, pardonne les errances et oublie les pleurs. En novembre 2018, j’angoissais. Je me demandais si mon obstination à rentrer au Gabon payerait. Ou si elle me perdrait. J’ai très vite constitué ma base de données de contacts RH. J’appelais, j’envoyais des mails tous azimuts, et j’espérais. En vain.
Tout en espérant, je m’occupais. J’ai eu la chance de donner des cours de Français, à des jeunes d’un collège de Port-Gentil (Collège Protestant Ogoula Mbeye). Je les aidais avec leurs cours, leurs révisions, leurs conjugaisons, et quelque part, je m’aidais. Je m’aidais, car je me confortais dans l’idée selon laquelle j’aurais mille plans B.
« Et alors ? », me disais-je ! Même si ce n’est pas dans la supply chain que je trouve du travail, je pourrais commencer une formation pour être institutrice. Ou mieux ! Professeure de français. J’ai adoré donner des cours !

J’en oubliais mes mille dossiers d’emploi, déposés ici et là. Je m’oubliais, à la faveur de mes élèves, qui prenaient désormais toutes mes heures. J’acceptais peu à peu l’idée d’un plan B.
J’acceptais enfin l’idée de m’être éventuellement trompée de voie, quand j’ai reçu non pas un, mais DEUX appels pour des entretiens d’embauche. Et quels appels ! J’ai passé ces deux entretiens à deux jours d’intervalle avec une certitude folle : ces deux entreprises me voudraient et me rappelleraient. Je savais que j’avais fait mouche.
Mon beau-frère, qui est pour moi un frère, m’a dit à la veille d’un de ces entretiens « Ma petite, toi tu es une chômeuse de luxe. Je ne dis pas que tu n’as pas besoin de ce travail. Mais tu vis chez tes parents. Ils s’occupent bien de toi. Tu peux te taper le luxe de rester au chômage encore cinq ans, avant que tes parents ne pensent à te demander des comptes. Malgré tout, TU VEUX TRAVAILLER. Donc pars à cet entretien comme si ta vie en dépendait. Vas-y comme si sans CE job, ta vie était finie. » Il a des conseils bizarres parfois mon beau-frère, rires. Mais celui-là, je l’ai pris avec mes tripes! Bien sûr, j’ai tout niqué déchiré !

J’ai eu de la chance. Beaucoup de chance. Cependant, cette chance, je l’ai préparée pendant six années. J’ai étudié pour cela, j’ai travaillé pour cela et j’ai espéré, longtemps, pour cela. Je n’ai pas fait d’écoles de commerce, ni eu un parcours prestigieux, mais je n’ai jamais douté en ma capacité à atteindre mes objectifs. Et même quand le vent du doute commençait à pointer son nez, je ne pensais pas avoir fait une erreur. Ou être en échec. Je me mettais à idéaliser une autre voie, qui est celle de l’enseignement. (Spoiler alert : J’espère revenir à l’enseignement, dans quelques années.)
En l’espace d’une seule fucking semaine, tout se concrétisait. Les deux entreprises m’ont rappelée, et cerise sur le gâteau ? Un mois après, une autre entreprise pour laquelle j’avais postulée 7 mois plus tôt me contactait aussi. Guys… l’histoire de mon non-retour a pris six années, mais elle s’est concrétisée en sept jours. J’ai signé dans la première entreprise à m’avoir rappelée. Non pas parce que c’était la première (nonsense) mais parce que je savais que c’était celle au sein de laquelle je pourrai le mieux m’épanouir, développer mes compétences et atteindre mon plein potentiel (professionnellement parlant, n’exagérons rien ! ). Cela fait 1 an que j’y suis et je n’ai toujours pas été déçue. Les légendes populaires gabonaises qui parlent de promotions-canapé, franc-maçonnerie et brimades au travail, je les ai toutes entendues depuis ma tendre enfance. Je m’attendais donc au pire. Je me suis préparée au pire. Mais rien, RIEN ne m’avait préparée à ce que j’aime AUTANT mon travail au Gabon. C’est dynamique, je dois souvent me rendre sur site (à l’intérieur du pays), aucune journée ne se ressemble, et surtout, lorsque je me pose devant mon laptop, c’est avec le sourire jusqu’aux oreilles. L’histoire de mon non-retour, c’est l’histoire de ma détermination, ma chance et ma gratitude. J’ai rarement été aussi reconnaissante envers La Vie que depuis que je suis rentrée au Gabon. Peut-être parce que face à mon pays qui sombre… je me rends compte que je dois dire MERCI !
Vivre au Gabon, quand on aime le Gabon

Vivre au Gabon est loin d’être une sinécure. Si je l’ai sous-entendu une seule fois dans cet article : MEA CULPA, ce n’était pas du tout mon intention, rires. Vivre au Gabon, c’est composer avec les coupures d’eau et d’électricité. D’ailleurs, cette pratique est tellement normalisée que la Société d’Eau et d’Electricité du Gabon (S.E.E.G.) se permet de nous envoyer des programmes de délestage.
« Oyé oyé, pitoyables gueux ! Sachez que du 1er mars au 14 mars 2020, tous les jours, de 18h00 à 22h00 et de 02h00 à 06h00… vous n’aurez ni eau, ni électricité. Allez, circulez ! »
S’ils parviennent à prévoir exactement quand et quels quartiers ils vont priver d’électricité sur deux semaines, je suis persuadée qu’ils pourraient prévoir comment ne pas tout simplement léser ces zones, de longues heures durant. *consternation face*
Vivre au Gabon, c’est également accepter d’acheter des denrées alimentaires à des prix exorbitants. Dans le secteur de la grande distribution, c’est tout à fait normal de vendre un pot de Nutella de 400g à 7.000 fcfa (10 €) soit 150% plus cher que le prix de base. Ou de vendre le set de poivrons tricolores à 8.500 fcfa (12,60 €), quand ailleursce même set est vendu 02 €. Je ne souhaite même pas parler des produits Netto, Casino, et toute autre marque premiers prix (marques discount), revendue à prix d’or en terre gabonaise. Pourtant, ils savent, vous savez, nous savons tous, que ces magasins bénéficient de régimes douaniers préférentiels !
Vivre au Gabon, c’est se passer parfois souvent de voyages. Il faut un visa, faire escale à Libreville (pour ceux qui ne vivent pas à la capitale), avoir les moyens d’acheter un billet auprès de compagnies à l’international et pouvoir supporter les dépenses du séjour. Considérant le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) à 150.000 fcfa (306 $), la probabilité que le travailleur gabonais moyen puisse s’offrir des vacances à l’étranger (même sur le continent) est nulle.
Vivre au Gabon, c’est payer 35% d’impôt sur le revenu, pour avoir un système de retraite, de santé, d’éducation, de sécurité, qui ne fonctionnent pas. Vivre au Gabon, c’est devoir ronger son frein face à la mal-gouvernance, la corruption, le tribalisme et la discrimination.
En fait, vivre au Gabon, c’est être impuissant. Tous les jours. Tout le temps. Partout.
Jusqu’à ce que tu te rappelles que rêver rend puissant. Rêver rend grand. Et ce qui est possible au rêve, est possible au quotidien, avec une bonne dose de détermination, de planification, et un soupçon de « j’étais là au bon moment, et j’ai fait en sorte que ce moment soit mien ».
À ceux qui n’en peuvent plus de subir les délestages de la SEEG, et si nous nous penchions sur les énergies renouvelables, solaires, photovoltaïques, thermiques, hydrauliques, géothermiques, éoliennes ou biomasses? Je suis certaine que parmi mes frères gabonais, il y en a aujourd’hui qui auraient les moyens de développer une entreprise spécialisée dans la vente d’équipements fournissant ce type d’énergie naturelle. Ne serait-ce qu’à petite échelle.
Notre pouvoir d’achat, face aux délires des chaînes de grande distribution, devrait nous interpeler et nous ramener à une consommation essentielle, authentique et moins occidentalisée. Pourquoi nous plaignons nous du prix du Nutella, lorsque le cacaoyer pousse sur nos terres, et ce, sans l’action délibérée d’un cultivateur ? Pourquoi nous plaignons-nous, alors que poussent mangoustans, pastèques, oranges, ananas, arachides, sans nul besoin de serres, tracteurs, voies d’irrigation, pesticides et tout autre moyen agricole ? Et si nous privilégions une alimentation plus saine, loin des géants Mosanto, Ferrero, Nestlé et cie ? Une alimentation avec moins de conservateurs, additifs, colorants et exhausteurs de goût est à la portée de tout ménage gabonais. Je ne suis pas vegan, végétalienne, végétarienne, ou tout autre adjectif en vég- . J’aime le chocolat industriel, les céréales du matin et les légumes surgelés qui se conservent longtemps. Mais je crois aussi fermement en la nécessité de retrouver nos aliments et plats traditionnels. Je ne propose pas non plus de déconstruire toutes nos habitudes alimentaires… mais plutôt d’épouser notre terre, afin d’en manger plus souvent les fruits. Des fruits frais, peu chers, sains et nourrissants. Le meilleur doigt d’honneur que nous puissions faire à l’industrie agroalimentaire est celui-là : Planter, cultiver, et CONSOMMER LOCAL.

Pour ce qui est des possibilités d’évasion, je suis la même injonction. Consommons local. Visitons Omboué, Lambaréné, Fougamou, les grottes de Lastourville (inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2005), les chutes de Poubara, le lac bleu de Mouila, les plateaux Batékés et les plages de Mayumba. Visitons le Gabon. Evadons nous au Gabon ! Bien sûr, ma bucket list regorge de pays à visiter autres que le Gabon, mais lorsque les finances sont au plus bas, il nous reste de très belles alternatives locales.


Vivre au Gabon, quand on aime le Gabon, c’est faire preuve d’une extrême résilience. Dans ma ville, il n’y a ni librairie, ni bibliothèque, ni centre culturel (je vous en parlais déjà dans l’article Lire sans se ruiner lien). Plutôt que de m’apitoyer sur mon sort, j’ai créé un petit club de lecture (le formulaire d’adhésion est téléchargeable ici !) au sein duquel nous parlons livres, culture, et bien d’autres sujets, au fil de nos digressions. Nous échangeons des livres, nous en achetons aussi, nous partageons des expériences et des idées. Nous sommes tous plus ou moins jeunes, gabonais, et nous avons, chacun à notre façon, cette flamme de découvertes, d’accomplissement et de renouveau.
Au quotidien, il est vrai que j’ai mille raisons de perdre foi en ma vision et en mes choix. Puis je me rappelle que j’ai deux mille autres raisons d’œuvrer pour que cette vision et ces choix de vie se concrétisent. En fait, c’est incroyable à réaliser… mais vivre au Gabon, autant ça écorche mes rêves et me fait douter de moi-même… autant ça aiguise ma capacité à espérer.
Espérer… c’est un bon début, ne trouvez-vous pas ?
.
.
.
.
Après plus d’un an d’absence sur le blog, merci est un mot infiniment faible. Mais c’est aussi le mot le plus vrai, pour exprimer ma gratitude.
Merci à vous. Merci d’être là. Merci de m’avoir lu.
A très bientôt,
Izuwa.